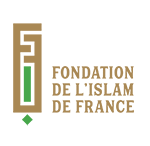Y a-t-il une question laïque en France depuis le début des années 1980 ?

Par Jean-Pierre Chevènement, Président de la Fondation de l’Islam de France
3 octobre 2018
Il a fallu plus d’un siècle entre la proclamation des libertés d’opinions, « même religieuses », par la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) et le vote de la loi sur « la Séparation de l’Église et de l’État » (1905). C’est le temps qu’il a fallu à la République pour fixer sa doctrine en matière de religion. Rien d’évident au départ dans un pays où le catholicisme constitue la religion très largement majoritaire des Français.
Au début, il y eut la tentation de s’assurer la fidélité du clergé aux institutions que fonde désormais non plus le droit divin mais la souveraineté populaire. Ce fut en 1790 la « Constitution civile du clergé » qui déboucha sur l’opposition entre les prêtres assermentés (ou « jureurs ») et les prêtres réfractaires, origine profonde des guerres de Vendée. Puis se fit jour, avec le « Culte de l’Être suprême », la tentation rousseauiste, c’est-à-dire déiste, de donner une religion à la République pour l’adosser à l’idée d’un « sacré ». Cette idée, si contraire à l’esprit voltairien ou à la philosophie des Encyclopédistes qui imprégnaient la majorité des membres de la Convention Nationale, perdit Robespierre. L’idée de laïcité, pensée par Condorcet, n’était pas mûre. Les tentatives de déchristianisation heurtaient le sentiment profond du pays. Esprit pratique, Bonaparte reconnut le catholicisme non comme religion de l’État, mais comme la religion de la majorité des Français.
Poussant à son terme la logique du gallicanisme, il imposa au Pape le Concordat de 1801, tout en préservant la liberté des autres cultes, quitte à les organiser, ce dont ceux-ci s’accommodèrent fort bien, tout comme d’ailleurs le catholicisme le fit du Concordat.
Ce compromis réaliste a duré plus d’un siècle. La Seconde République a ignoré la question de la laïcité. La troisième ne s’y est référée qu’avec d’infinies précautions.
Le mot « laïque » n’est introduit que dans les lois scolaires des années 1880. Ce n’est pas le fait du hasard. L’école publique est qualifiée de « laïque » parce qu’elle met au-dessus de tout, la liberté de conscience. On connaît l’exhortation de Jules Ferry dans sa « lettre aux instituteurs » leur enjoignant des respecter avant tout « cette chose sacrée qu’est la conscience d’un enfant ». C’est à l’École qu’il revient d’éduquer le citoyen à la liberté, c’est-à-dire à l’exercice autonome de son jugement.
Ce n’est donc pas sans raison que, dans l’esprit des républicains, la « question scolaire » a occupé la première place dans le débat sur la laïcité. On voit bien l’enjeu que représentait au 19ème siècle, entre l’Église du « Syllabus » (1864) et la République qui se voulait fille de la Révolution, la formation de l’esprit des jeunes enfants.
Remarquons cependant que le mot « laïque » ne figure pas dans le texte de la loi de 1905. Celle-ci pose un principe : la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte – mais la loi déroge immédiatement à ce principe en créant des aumôneries dans les établissements publics fermés (lycées, hôpitaux, prisons). Au fil du temps, les exceptions vont se multiplier, au premier rang desquelles le maintien du Concordat dans les départements d’Alsace-Moselle, au lendemain de la reconquête des provinces perdues. Le Cartel des gauches, avec Edouard Herriot, admet implicitement que le souci de l’unité nationale l’emporte sur l’application généralisée à tout le territoire du principe de stricte séparation puisque les ministres des cultes reconnus y sont salariés. Une semblable exception avait été faite pour d’autres raisons pour les départements algériens, à majorité musulmane, à titre provisoire d’abord puis définitif : l’administration coloniale trouvait son compte à la salarisation des imams et des cadis.
D’autres exceptions virent successivement le jour : baux emphytéotiques pour la construction des mosquées, dérogations pour les « villes nouvelles » et surtout financement des écoles confessionnelles associées au service public par les lois Marie (1951), Debré (1959) et Guermeur (1977).
Le projet de loi portant création d’un grand service public unifié et laïque de l’Éducation nationale (GSPULEN) porté par le gouvernement Mauroy et son ministre de l’Éducation nationale, Alain Savary (1981-1984), remit le feu aux poudres en jetant sur le pavé parisien, en juin 1984, un million et demi de manifestants.
Cette manifestation, qui entraîna un changement de gouvernement et accessoirement mon arrivée au ministère de l’Éducation nationale, en juillet 1984, était cependant l’arbre qui cachait la forêt.
En quatre-vingts ans, le paysage s’était considérablement modifié : l’Eglise n’était plus ce qu’elle avait été. En même temps que le cléricalisme, l’anticléricalisme avait reflué. Bien sûr, il restait dans les tréfonds des consciences une vieille ligne de fracture, mais il fallait mettre beaucoup de maladresse ou de malignité pour la réveiller.
Ce fut l’effet pervers du projet de « GSPULEN », projet réchauffé par les syndicats enseignants quand la gauche était dans l’opposition mais dont la visée pour le parti socialiste était essentiellement électoraliste.
Les consignes données par le Président de la République François Mitterrand à son ministre de l’Éducation nationale (« nationaliser à travers une concertation », « convaincre sans contraindre ») étaient suffisamment floues pour que l’historien puisse penser, a posteriori, que le projet de grand service public unifié et laïque de l’Éducation nationale était en réalité fait pour être retiré après édulcoration préalable, si celle-ci ne paraissait pas suffisante aux établissements privés.
L’attachement aux écoles dites confessionnelles répondait d’ailleurs plus à un réflexe consumériste – avoir un choix diversifié pour scolariser ses enfants – qu’à une véritable ferveur religieuse. Quant aux soutiens de l’École laïque, ils s’effrayaient à l’idée de voir le service public se dissoudre à travers la généralisation de « projets d’établissements » particuliers.
Dans le même temps, le paysage religieux de la France s’était profondément modifié. Tandis que la pratique catholique, depuis les années soixante, reculait fortement, l’islam s’était hissé au rang de seconde religion française avec un nombre de pratiquants supérieur à la moitié de la population de tradition ou de culture musulmane, soit 4 millions environ. C’est pourquoi la querelle scolaire, en 1984, fut promptement réglée. Par une déclaration du 25 août 1984, je fis connaître que les établissements d’enseignement privé associés au service public de l’Education nationale devraient en respecter les règles, notamment budgétaires, les programmes et les procédures, et bien sûr l’esprit, c’est-à-dire la liberté de conscience. Ces dispositions « simples et pratiques » abolissaient la loi Guermeur, (laquelle enlevait à l’autorité académique la nomination des maîtres du privé) et revenaient à l’esprit de la loi Debré (1959) qu’avaient en fait préparée deux responsables socialistes, André Boulloche et Pierre-Olivier Lapie. Elles éteignirent la « querelle scolaire » comme par miracle. En fait, elles revenaient à un point d’équilibre dont une véritable gauche de gouvernement n’aurait jamais dû s’écarter.
Autrement plus difficile à traiter était l’émergence de l’islam dans les lieux où se concentraient les populations d’origine maghrébine : grandes entreprises et banlieues ouvrières.
La revendication de salles de prières sur les lieux de travail apparut au début des années 80 : c’était la première manifestation de l’ethnicisation des problèmes sociaux au nom de la religion. La revendication sociale va de plus en plus prendre la forme d’un séparatisme identitaire de fait (Vaulx-en-Velin etc.), fondé sur des mœurs associées, à tort ou à raison, à la religion.
Du début des années 80 datent également les premières émeutes urbaines qui cependant ne prirent pas d’emblée la forme de manifestations identitaires, comme en témoigne la « marche des Beurs » de l’automne 1983, encore sous-tendue par la revendication républicaine d’égalité.
Le contexte n’en a pas moins changé : l’immigration familiale s’est substituée à l’immigration de travail depuis la fin des années 1970.
En 1982, le cap des deux millions de chômeurs est franchi.
Les années 1983-1984 marquent l’irruption sur la scène politique du « Front National » (municipales de Dreux, élections européennes de juin 1984). En réponse, la gauche mobilise sur le thème de l’antiracisme (S.O.S Racisme), substituant au combat social un combat moral, et contribuant ainsi, à sa manière, à l’ethnicisation de la question sociale.
C’est dans ce contexte, au lendemain de la réélection de François Mitterrand de 1988, qu’éclate au collège de Creil l’affaire dite « du foulard ». Ce n’est pas par hasard que c’est à l’école que se cristallise ce renouveau soudain de la question laïque. Faut-il confier aux chefs d’établissements le soin de réglementer le port dudit foulard ? C’est ce que décide le Conseil d’Etat, sollicité par le ministre de l’Education nationale de l’époque. Il faudra attendre 15 ans (2004) pour qu’une loi, votée à l’initiative de la « Commission Stasi », vienne interdire le port, dans les enceintes scolaires, de « signes ostentatoires d’appartenance religieuse ». Cette loi contrarie évidemment le développement en France du port du voile islamique dans les établissements scolaires, à l’image d’une pratique qui était étendue dans les pays musulmans depuis quatre décennies.
Cette loi a évidemment quelque chose à voir avec la laïcité, contrairement à la loi de 2010 interdisant la burqa dans l’espace public en général. Celle-ci a à voir avec la sécurité publique (nul ne peut dissimuler son visage dans ledit espace public).
L’interdiction du voile à l’École intervient, quant à elle, dans l’espace de formation au débat public. Elle répond à la logique de la laïcité.
La laïcité française ne proclame pas seulement en effet une simple neutralité de l’État vis-à-vis des religions. Elle a une dimension historique et culturelle essentielle : dans l’espace du débat public, les citoyens sont invités à s’exprimer à la lumière de la raison naturelle, à travers une argumentation si possible rationnelle, plutôt qu’en se retranchant derrière une Révélation religieuse qui appartient à chacun, et où chacun peut trouver la source de ses motivations mais que nul ne peut asséner comme article de foi à ses concitoyens.
La laïcité française étaye naturellement le principe de la citoyenneté dont elle est quasiment l’homonyme : dans l’espace public de débat (et a fortiori dans l’espace de formation au débat qu’est l’École) les religions sont tenues de s’exprimer avec une certaine discrétion, comme je l’ai rappelé en prenant mes fonctions de président de la Fondation de l’Islam de France. Ceci n’empêche nullement l’enseignement laïque du fait religieux. Mais cela interdit bien évidemment le prosélytisme au sein de l’enceinte scolaire.
Le port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse ne met pas seulement en cause l’esprit de l’École publique (ce pourquoi il trouve quelquefois des concours inattendus). Quelles que soient ses motivations, le port du voile islamique est une atteinte au principe d’égalité : en désignant des jeunes filles ou des jeunes femmes comme « musulmanes », il signifie l’interdiction qui leur est faite par l’islam d’épouser un « non musulman ».
Cette signalétique vestimentaire plus encore que les habitudes alimentaires débouchent sur un séparatisme identitaire de fait. Dès lors que la religion n’est plus seulement une affaire de croyance mais une affaire de mœurs, elle peut heurter les valeurs républicaines. Comme l’écrit Philippe Gaudin : « Si le voile désigne au premier coup d’œil une femme comme étant musulmane, cela signifie en Islam (qu’elle le sache ou non, que cela lui plaise ou non) qu’elle est réservée à un homme musulman et que ses enfants seront, du seul fait de leur naissance, des musulmans ».
Et Philippe Gaudin ajoute que ce point de vue est celui de tous les fondamentalistes y compris les quiétistes. On comprend que cela pose problème :
« Que signifie s’installer ? Choisir de vivre dans un pays dont les libertés présentent un avantage ? ou bien imposer un mode de vie modelé par l’Islam ?» [i][1]
La question posée déborde la laïcité. Elle met en jeu la citoyenneté et la cohésion sociale.
Il est temps d’y réfléchir sérieusement. Les musulmans qui choisissent de devenir Français devraient plutôt être incités à adopter les us et coutumes de la société d’accueil. En contrepartie, nos concitoyens de confession musulmane bénéficient des libertés qu’offre la République y compris en ce qui concerne la relation entre les hommes et les femmes. Et la société d’accueil devrait les convaincre qu’il s’agit là d’un progrès pour tous. Je préconise pour cela les moyens de la conviction et non de la contrainte, mais si les Pouvoirs publics pouvaient faire état de cette conviction, cela changerait bien des choses.
En effet, la laïcité n’a pas été qu’un combat culturel. C’est aussi un cadre propice à l’expression de conscience et par conséquent de la liberté religieuse. La laïcité n’est pas tournée contre la religion, bien au contraire. Elle ne signifie nullement l’athéisme ou l’agnosticisme. Elle sépare le religieux et le politique.
L’Islam, de ce point de vue, a tout à gagner à s’inscrire dans le cadre de la laïcité dès lors qu’il se veut compatible avec les valeurs de la République.
C’est ce qu’ont compris – je l’espère – les différentes sensibilités de l’Islam de France quand, ministre de l’Intérieur, je les ai conviées à signer, le 29 janvier 2000, la Déclaration relative aux rapports entre le Culte musulman et les Pouvoirs publics*. La Consultation que j’ai lancée a permis des avancées notables. Nous ne sommes plus aujourd’hui à l’époque de l’Islam « des caves et des garages ».
De très nombreux progrès ont eu lieu (constructions de centaines de mosquées, carrés musulmans dans les cimetières, aumôneries musulmanes militaire, hospitalière et pénitentiaire). Reste la question de la formation des imams encore aujourd’hui mal résolue. De la Consultation lancée en 1999 a émergé en 2003 le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM). Un long travail de concertation a permis d’esquisser, depuis 2016, une organisation à deux piliers : d’une part une Fondation à vocation culturelle et donc profane, la Fondation de l’Islam de France, et d’autre part une Association cultuelle à vocation religieuse, dont la mise en place dépend d’abord des musulmans eux-mêmes.
Dans le contexte troublé que la France connaît depuis 2015 (attentats djihadistes), rien ne serait plus important qu’une prise de conscience et de responsabilité des autorités religieuses musulmanes pour dire non pas ce que n’est pas l’Islam mais ce qu’il est : une religion compatible avec la liberté et l’égalité, telles qu’elles sont conçues dans les sociétés modernes.
La laïcité donne aux musulmans eux-mêmes et à eux seuls cette responsabilité d’interpréter leurs textes sacrés.
On ne peut pas dire que la République laïque, si souvent caricaturée, n’ait rien fait depuis deux décennies pour favoriser l’émergence d’un « Islam de France ».
Nous touchons là à une limite de la laïcité : elle a les mains pures, comme la morale de Kant, mais elle n’a pas de mains. C’est pourquoi je recommande des initiatives pragmatiques comme la création d’une Faculté de théologie musulmane à Strasbourg. Cette décision ne dépend que de l’Université de Strasbourg qui compte déjà une Faculté de théologie catholique et une Faculté de théologie protestante. La formation des imams est une chose trop sérieuse pour que l’État puisse s’en désintéresser.
Je ne suis donc partisan ni d’une laïcité édulcorée (c’est-à-dire répudiant son ancrage dans l’esprit des Lumières), ni d’une laïcité tracassière qui multiplierait les interdictions dans l’espace de circulation publique (dans la rue ou les supermarchés), et encore moins d’une laïcité réduite à l’impuissance.
La loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 a été votée avant que l’Islam ne s’implante en France.
C’est dire que les cultes « reconnus » (catholicisme, protestantisme et judaïsme) ont pu s’organiser préalablement avec le concours de l’État, ce qui a facilité ultérieurement leur insertion dans le paysage laïque. Il en va différemment de l’Islam, religion en elle-même peu organisée et privilégiant la communication directe des croyants avec Dieu. Dans les pays musulmans – « Dar el Islam » – l’État apporte naturellement son soutien à la religion musulmane, c’est-à-dire qu’il l’organise. Mais la France n’est pas un pays musulman. C’est une République laïque de tradition majoritairement catholique. Cela ne doit pas se traduire par le constat suivant : « Depuis 1905 la laïcité est impuissante à créer les conditions de l’accueil d’une religion nouvelle comme l’Islam ». Celui-ci a besoin d’un coup de pouce pour s’organiser de manière compatible avec la République et les Pouvoirs Publics doivent pouvoir le donner au nom des responsabilités qui sont les leurs en matière de sécurité et de santé publiques et, j’ajoute, de cohésion sociale. Il faut prendre sans hypocrisie les moyens d’une laïcité bien comprise où les imams pourront être formés au même niveau que les autres ministres du culte, curés, pasteurs et rabbins, et donc rémunérés. Car on ne combattra que par l’éducation et la culture les dérives salafistes qui sont le terreau du terrorisme djihadiste. Bien sûr, au-delà de l’aspect cultuel des choses, il appartient à la République d’assurer à tous les citoyens une réelle égalité devant l’éducation, le logement et l’emploi. Cela va bien au-delà des opérations de « testing » à l’entrée des discothèques ou même dans les entreprises. Cela implique toutes les politiques publiques et d’abord la politique économique qui, enfermée dans les contraintes de l’euro, ne génère depuis 2010 qu’une croissance insuffisante.
« Ici commence le pays de la liberté », pouvait-on lire sur les panneaux frontaliers de la Première République. Le repli identitaire qu’affichent certains de nos concitoyens à travers une signalétique vestimentaire ou capillaire particulière (et cela s’applique à toutes les religions) pose problème, mais ce n’est pas tant un problème de laïcité que de cohésion sociale, ou si l’on préfère de bonne intégration à la communauté des citoyens qui est la définition de la République française. L’intégration souvent caricaturée veut simplement dire « appropriation des codes sociaux qui permettent à la liberté de s’exercer ».
A juste titre, le CFCM a réclamé pour les musulmans vivant en France un « droit à l’indifférence ». Mais qui ne voit que ce « droit à l’indifférence » implique qu’on ne multiplie pas les signes de sa différence ?
Il me semble que c’est l’intérêt bien compris de nos concitoyens musulmans de faire l’effort qu’ont fait, avant eux, les vagues migratoires successives qui ont façonné la France au long des siècles.
C’est la seule manière de prévenir les antagonismes, les surenchères et les différentes formes de radicalisation. Il va de soi qu’en contrepartie, la République doit faire l’effort d’intégrer les nouveaux citoyens, non seulement au plan économique et social, mais aussi et surtout à travers leur apport à la construction de notre Nation : la France d’hier et plus en encore celle du XXIe siècle.
Je connais bien évidemment tous les arguments mis en avant pour justifier une altérité de mœurs qui – osons le dire – ne peut que saper la cohésion sociale et créer les conditions d’un affrontement que notre tâche est de prévenir par un effort de compréhension et d’éducation réciproques.
Ces arguments (piété, pudeur) ne sont pas sérieusement étayés par les textes sacrés de l’Islam (je me le suis fait plusieurs fois confirmer par les plus hautes autorités religieuses de l’Islam). Bien sûr, ce peut être une forme d’affirmation identitaire. Mais une telle affirmation sert-elle la concorde civique ? Je ne propose pas d’interdire tel ou tel affichage, mais je ne m’interdis pas, comme dans ces colonnes, de dire ce que j’en pense. La confrontation des idées est nécessaire. Car il en va de la concorde civile et de l’amitié civique qui répondent à l’intérêt de tous nos concitoyens, à commencer par ceux de confession musulmane.
Ai-je, en développant cette opinion, outrepassé les bornes de la bienséance ?
Il me semble que j’ai seulement voulu aider à l’émergence tranquille au sein de la société française d’un Islam éclairé, moderne et accepté de tous. C’est d’abord une affaire de cohésion sociale et de bonne intégration.
Ce n’est que secondairement une affaire de « laïcité ».
Cessons de caricaturer celle-ci et essayons de la comprendre à la lumière de son contexte historique et sociologique.
La loi de 1905 a posé un principe, celui de la séparation et donc de neutralité de l’État, principe auquel elle a d’emblée apporté quelques exceptions.
Il me semble que le modèle républicain a une ambition plus vaste : prévenir les dérives communautaristes et différentialistes qui susciteraient ou aggraveraient des phénomènes de ségrégation et des inégalités croissantes au sein de la société française. La République a quelque chose à voir avec l’égalité et le slogan « égaux mais séparés » qui était la justification de l’apartheid ne saurait être le sien. C’est à ce combat d’idées qu’il faut appeler nos concitoyens à participer, quelle que soit leur religion ou leur croyance pour « faire France » à nouveau. Une France multiethnique, multiconfessionnelle mais pas « communautariste », au sens où la loi doit y rester la même pour tous.
Ce combat exigeant pour tous va au-delà de ce qu’implique une stricte définition de la laïcité mais pas de ce qu’exige la République. Celle-ci est un corps de principes cohérent dont on ne peut isoler un seul (la laïcité, la citoyenneté ou l’égalité) sans ruiner l’ensemble.
[1] Philippe Gaudin, Tempête sur la laïcité, Ed. Robert Laffont 2018, p.38-39.
* Extrait de l’ouvrage de Jean-Pierre Chevènement, Défis républicains, Paris, Fayard, 2004, p.612-620.