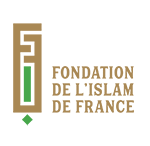« L’islam de mon enfance était paisible, festif et lumineux »
Grand entretien.
Le Monde des Religions, sept.-oct. 2019, propos recueillis par Virginie Larousse.
Vous êtes devenu en décembre 2018 président de la FIF, fonction que l’on sait minée de toutes parts (accusation d’ingérence de l’État, institution que l’on dit coupée de la base, etc). Pourquoi avoir accepté cette mission quasi-sacerdotale, que vous exercez qui plus est à titre bénévole ?
Tout simplement par cohérence. À vrai dire, ce n’est que lorsque l’on m’a sollicité pour la seconde fois que j’ai accepté cette mission. Je me suis dit que je ne pouvais pas m’égosiller depuis près d’un quart de siècle à dire l’importance de la culture, de la connaissance et surtout de l’éducation, tout en refusant d’être candidat à la présidence d’une fondation dont les maîtres-mots sont précisément l’éducation, l’instruction, la culture comme antidotes à la radicalisation.
Revenons sur votre parcours. Vous êtes né à Djeddah, en Arabie saoudite, en 1960, mais vous êtes d’origine algérienne. Quel lien avez-vous avec l’Arabie saoudite ?
C’est le déterminisme de la vie. Mon père était un théologien reconnu, membre de l’association des Oulémas (docteurs de la loi), un orateur fougueux défendant des idées réformistes… Son savoir en théologie islamique était immense. Il s’était formé à l’université Qaraouiyine de Fès, à la Zitouna de Tunis, à l’université Al-Azhar du Caire. Parallèlement, il menait une carrière de diplomate et a été ambassadeur une partie de sa vie, notamment auprès du royaume d’Arabie saoudite. Voilà ce qui explique ma naissance sur les bords de la mer Rouge. Garçonnet, ma mère m’a accompagné à La Mecque à deux reprises, au moment du pèlerinage.
Vous êtes donc le fils de cheikh Abbas, un homme réputé pour sa sagesse et sa tolérance. Comment qualifieriez-vous l’éducation que vous avez reçue ?
Il y avait en cheikh Abbas une exigence d’amour, de respect, de reconnaissance, de sollicitude, de prise en compte de l’intérêt d’autrui. L’éducation que nous avons reçue à la maison est difficile à définir. Il y avait d’abord la stature d’un homme qui nous écrasait, avec beaucoup de rigueur, d’exigence, de valeurs également - probité, ouverture, amour de la connaissance et du savoir. Mon père était par ailleurs favorable aux débats intrafamiliaux. Il aimait organiser des discussions bilatérales ou des sortes de mini-colloques à la maison. Nous abordions un sujet quelconque et il demandait à chacun de défendre sa thèse, puis de défendre le point de vue inverse. C’était une occasion à la fois de décentrer notre regard et de nous montrer comment on peut relativiser un point de vue, nous prémunir du dogmatisme. Je regrette aujourd’hui de n’avoir pas suffisamment profité des immenses connaissances de cheikh Abbas. À l’époque, mon sentiment était ambivalent, entre la conscience de son caractère exceptionnel et la tentation de fuir sa stature imposante.
Et du côté maternel ?
Ma mère était très pieuse. Je pourrais dire de manière prosaïque qu’elle avait la foi du charbonnier. À ses yeux, rien sur ce plan n’était négociable. Elle n’intellectualisait pas le rapport au divin, à la foi. C’était dans l’ordre naturel des choses. Mais elle se retrouvait dans les décisions de mon père, en ce sens que pour elle aussi les études étaient fondamentales.
À quoi ressemblait l’islam de votre enfance ?
Ah ! Du bonheur ! Paisible, festif et lumineux. J’ai passé mon adolescence à Alger, que l’on surnomme « la Blanche ». Ce n’est pas pour rien : l’éclat de la ville est extraordinaire. De la musique, de l’élévation spirituelle. Nous n’étions absolument pas pollués par la crétinisation actuelle du « tout est illicite, tout est interdit »… Il y avait une bonne hybridation entre une vie ancrée dans la modernité et un enracinement dans une authenticité d’approche spirituelle.
À quel moment avez-vous découvert la France ?
La France, c’est quasiment une histoire familiale. Je suis arrivé jeune étudiant. Si nous venions parfois en France pour les vacances, il se trouve que mon père a été nommé recteur de la Grande Mosquée de Paris. De ce fait, la famille l’a suivi. À l’époque, j’avais décroché une bourse pour aller étudier la physique aux États-Unis, mais j’ai finalement préféré la France. J’ai vécu sous le même toit que mon père, dans les appartements privés du recteur. La beauté de la ville lumière a atténué à ce moment-là les tracasseries de l’âge adulte, quand je vaquais à mes occupations d’étudiant en sciences. Le lien avec la France était quasi-charnel. Mon père, au nom même des valeurs de la Révolution française, des Lumières, s’insurgeait contre l’abomination absolue que fut le colonialisme. Il a même connu les affres de la geôle, sur ordre de Mitterrand - qui plus tard le décorera pour son humanisme et son engagement au service de la personne humaine. La vie est faite de quelques paradoxes…
Comment vivez-vous ce multiculturalisme qui vous a façonné ?
Harmonieusement, mais je préfère parler d’hybridation culturelle. J’ai grandi dans un environnement où nous parlions français et arabe. Pour l’arabe, il s’agissait à la fois du dialectal et de l’arabe classique - une langue suggestive, poétique, lyrique, belle, une langue de savoir et de diplomatie. J’aurais aimé que cette hybridation fût élargie à d’autres sphères, à d’autres langues, au monde anglo-saxon. Dans le domaine musical, par exemple, mon éclectisme va des Pink Floyd jusqu’à la musique arabo-andalouse, la musique persane, et les grands motets - le baroque, Rameau, Purcell…
À l’heure où chacun s’escrime à dire ce qu’est être Français, comment le définiriez-vous ?
Il y a peut-être deux aspects. Le premier, qui est une définition à la fois juridique et politique, c’est faire partie du groupe des citoyens formant la nation française. Le second, c’est faire sien le long héritage, celui de la roche-mère chrétienne d’une France venant du fond des âges, pour le dire avec un accent gaullien. Cette roche-mère a été consolidée dans sa sédimentation par d’autres apports. L’apport juif est considérable – avec Rachi de Troyes, Nissim de Marseille, Moshe Narboni, etc. J’ai la faiblesse de croire également à un apport islamique, que nous mettrons d’ailleurs en exergue dans le cadre d’une prochaine exposition organisée par la Fondation de l’Islam de France.
Nous ne devons pas nous laisser prendre en tenaille entre ces deux mâchoires que sont, d’un côté, ce que nous appelons l’islamisme politique (le wahhabo-salafisme et le radicalisme fondamentaliste), et de l’autre la fachosphère ou l’identitarisme suprémaciste. Pour sortir de cela, il faut revenir au pacte républicain, croire, sans chauvinisme aucun, qu’il y a un message, un modèle français - même si nous ne représentons qu’un pour cent de la population mondiale - à transmettre au reste du monde. Je crois que notre vie, sous la voûte commune de la laïcité, peut être un modèle transmissible ailleurs. Il ne s’agit certes pas de l’imposer mais de prendre en compte les spécificités intrinsèques à telle ou telle société. Quoi qu’il en soit, je pense que l’on ne doit pas se prévaloir de sa propre tradition religieuse pour imposer des règles de vie à son semblable. Il faut absolument développer cet acquis de la modernité qui consiste à désintriquer la politique d’avec la religion.
Vous êtes docteur en sciences physiques. Quel pont faites-vous être les sciences, domaine de la raison, et la religion, domaine de la croyance ?
Mes premières amours ont toujours été les sciences, et en particulier les sciences dites dures. Cela étant, lorsque j’ai rédigé ma thèse, je me suis dit que je n’allais pas passer ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques. J’ai donc suivi, parallèlement, un cursus en philosophie. Ce sont des moments extraordinaires de ma vie qui m’ont permis de fréquenter des professeurs tel Jacques Bouveresse, par exemple. En outre, comme mon père était recteur de la Grande Mosquée de Paris, je passais beaucoup de temps dans la bibliothèque. J’étais fasciné par les sommes théologiques notamment en langue arabe. Mais j’ai coutume de dire qu’il vaut mieux étayer les assises de la connaissance que de laisser place uniquement à la croyance, d’où le regard à la fois distancié et parfois critique que je porte sur les croyances – ce qui fait défaut à certains musulmans de nos jours. Je reste ouvert dans l’interrogation. Si je pense qu’il y a une origine non-mécanique à tous les mécanismes, je suis de ceux qui disent que la science seule est souveraine dans le décryptage du monde. Il n’est de conception du monde que scientifique. Simplement, la science nous dit comment est le ciel, et la religion nous dit comment on va au ciel - pour ceux qui y croient. Je fais mien cet aphorisme du Prophète qui dit que Dieu préférerait qu’on vienne à sa rencontre le jour du Jugement dernier tout en cherchant après lui, qu’en ayant cru en lui sa vie durant tout en le méconnaissant. Et qu’est-ce que le méconnaître ? C’est ne pas l’honorer en l’homme, qui est vicaire et icône de Dieu sur terre.
Si vous deviez ne retenir qu’un verset du Coran, quel serait-il ?
« Rends le bien pour le mal ». Ce verset, magnifique, est en réalité plus long : « Et quelle meilleure parole que de se dire : je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n’y parvient que celui qui sait faire preuve d’une grande patience et n’y parvient que celui qui est siège d’une grâce infinie » (sourate 41, 34). C’est bien sûr un idéal à atteindre. Ce verset est d’une grande force intérieure.
Comment est-ce que vous définiriez les valeurs essentielles de l’islam ?
Sincèrement, je ne pense pas qu’elles soient exclusivement islamiques. À l’extrême rigueur, elles pourraient être celles du monothéisme abrahamique. D’abord parce que la tradition religieuse islamique se veut continuatrice des préceptes, commandements, et de tout que l’on trouve dans la Torah et dans l’Évangile : magnanimité, longanimité, miséricorde, hospitalité, générosité, accueil, patience. Un énorme travail de maîtrise de soi, à conjuguer également avec les fameuses injonctions quant à l’acquisition du savoir, à exercer sa raison, son entendement. Le meilleur contre-exemple en est hélas Daesh.
Vous êtes partisan d’une refondation de la pensée islamique, sclérosée dans un héritage millénaire. Quels sont les chantiers prioritaires de la Fondation de l’Islam de France ?
Il y a quatre chantiers fondamentaux. D’abord celui de la liberté - liberté religieuse, liberté d’action, liberté de conscience surtout. C’est un chantier titanesque. On ne peut rien faire quand la liberté est entravée. Le deuxième chantier est celui de l’égalité ontologique fondamentale entre les êtres quels qu’ils soient. Si l’égalité homme-femme est affirmée avec force dans le Coran, elle n’est pas malheureusement traduite ni juridiquement ni dans les faits. L’avènement de l’islam a certes été un progrès spectaculaire pour la condition des femmes vivant en Arabie à cette époque. Mais figer ce qui fut un progrès à un moment donné de l’histoire devient inique à d’autres moments. Il faut savoir accompagner l’évolution des sociétés. Le troisième chantier est celui de la désacralisation de la violence. Il y a encore des imams qui qualifient les attentats suicides d’opérations martyres. Sans compter tous ceux qui manipulent les textes dans le sens d’une violence sacrée. Le quatrième chantier est celui de l’autonomisation de la sphère du savoir par rapport à celle de la Révélation islamique. Nous autres musulmans pâtissons de ce que j’appelle la pathologie du concordisme : « si cela concorde avec le Coran, c’est très bien, si cela ne concorde pas, c’est que vous avez mal compris ». Il faut affranchir la connaissance des présupposés de la foi.
Pour le reste, il faut renouer, en contextes islamiques, avec l’art de vivre, le raffinement, faire rimer humanisme et hédonisme. Laisser place à la beauté et à l’émerveillement devant les splendeurs de la Création et de la nature, mais aussi des Arts. Il y a une vertu salvifique et une dimension salvatrice de la beauté. Nous devrions tous y être sensibilisés.