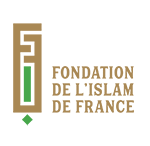L’habit ne fait pas le musulman ; l’école forme le citoyen

Entretien avec Ghaleb Bencheikh sur Libération mené par Clémence Mary
« Vêtement islamique » ou « religieux par destination », quel sens donnez-vous au port de l’abaya ?
Il est clair que ce n’est pas un vêtement religieux, encore moins un habit canonique. Rien dans la théologie islamique n’indique qu’il y ait un habit consacré. Il faut que l’on arrête avec cette affaire d’habits religieux islamiques. Ce n’est qu’un habit de la tradition proche-orientale, qui est aussi porté par des femmes coptes égyptiennes, des chrétiennes irakiennes ou yézidies. Voilà pourquoi on s’en mêle les pinceaux. Mais nous ne sommes pas dupes. Certaines élèves musulmanes, des jeunes filles le portent soit par provocation, soit par crispation identitaire, soit parce que des imams autoproclamés sur les réseaux sociaux les ont culpabilisées et les incitent à agir de la sorte. Ce serait aussi une solution de facilité : parce qu’elles viennent voilées, elles enlèvent leur foulard à l’entrée de l’établissement et restent avec l’habit ample.
Il y a donc dans ce débat une confusion entre ce qui relève du culturel et du religieux ?
Assurément, oui. Et encore, ce n’est pas de la culture. C’est une forme de bricolage et de rafistolage culturel. Or on doit juger sur des faits et pas sur les intentions, d’où le problème avec l’expression « religieux par destination » ou celle de « l’intention » de ces élèves. Que faire alors des sarouels, des babouches, ou des djellabas qui n’ont rien à voir avec la religion et qui seraient « religieux par destination » ? Certes, tout ce folklore n’est pas le bienvenu dans l’enceinte d’une école, au même titre que les crop-tops ou les jeans troués. Mais, les adolescents sont coutumiers des provocations ! Ces accessoires sont une manière d’afficher une appartenance, qui n’est pas nécessairement religieuse. C’est pourquoi l’école publique doit, sans forcément imposer un uniforme standard, exiger une tenue correcte – ce qui vaut pour une boite de nuit vaudra davantage pour un établissement scolaire. Cette bonne tenue concerne à la fois la conduite, le comportement et l’habillement.
Une nouvelle circulaire vous semble-t-elle nécessaire pour encadrer le port de ce vêtement, en hausse d’après les signalements ?
De deux choses l’une : soit on considère ce vêtement comme religieux, auquel cas il tombe ipso facto sous le coup de loi du 15 mars 2004. Laquelle loi doit-être appliquée sans barguigner. S’il ne l’est pas, c’est à l’Education nationale de poser un cadre vestimentaire clair sans avoir à recourir forcément au principe de laïcité. Encore une fois, l’école n’est pas le lieu du folklore, on n’y vient pas comme on est, ce n’est pas McDonald. Il est vrai aussi que les chefs d’établissement ont besoin de consignes claires. Il est évident qu’à un moment, l’école a manqué d’autorité, car la circulaire Fillon du 18 mai 2004 précisait déjà les modalités d’application de la loi à l’école. J’attends de voir la prochaine, qui – espérons-le, ne contiendra pas des failles juridiques ; les spécialistes nous le diront.
Comment expliquez-vous la hausse du port de ce vêtement ? Est-ce l’expression d’un rejet de la laïcité ou de l’institution scolaire de la part de certains jeunes ?
Ces signalements sont importants en valeur absolue et ils sont préoccupants, mais en valeur relative, ils restent ridiculement bas : 150 établissements sur 60 000 ! En outre, c’est loin d’être représentatif de l’ensemble des élèves musulmanes. Cela dit, même si l’on ne recensait que quelques cas, ils mériteraient d’être étudiés et traités, par principe. Pour moi, le port de ce vêtement entremêle crispation identitaire, provocation, volonté d’affirmer un mode vie singulier et une manière de tester l’autorité de l’institution. Ce serait aussi le fruit d’une facilité pratique et de l’offensive de ces pseudo-imams youtubeurs, ceux qui sévissent sur les réseaux sociaux dernière génération. Mais ce n’est en aucun cas le signe d’une incompatibilité de l’islam avec la République, comme certains veulent l’affirmer.
Réaffirmer certains principes de la laïcité peut-il aider à lutter contre une forme de radicalisation ou de communautarisme qui peut tenter certains jeunes ?
Maintenant que l’affaire s’est envenimée, on peut convoquer ce principe car il faut trancher et en finir avec cet épisode qui a assez duré pour passer à d’autres questions bien plus centrales au plan éducatif. Il est impératif d’en réaffirmer les principes mais seulement après une phase de dialogue. Et qui dit dialogue ne dit pas négociation. Après cette phase, la fermeté et l’autorité sont de rigueur. Ce n’est peut-être pas toujours bien compris, mais il faut l’appliquer drastiquement car on ne badine pas avec les principes. Et nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour s’affranchir de la règle commune.
Qu’est ce qui manque parfois dans ce dialogue ?
Selon la formule consacrée, la laïcité n’est pas un glaive, c’est un bouclier ; un principe de liberté. Mais concilier la liberté avec l’interdiction n’est pas toujours bien compris. Aussi faut-il des trésors de pédagogie, d’explication pour présenter à ces jeunes élèves l’histoire et le long combat de la laïcité qu’ils ne connaissent pas ou connaissent souvent mal. Il importe de leur transmettre que l’école doit être préservée du prosélytisme, du repli communautaire voire communautariste, et de la crispation identitaire.
Est-ce parce que la laïcité telle qu’elle est invoquée ces dernières années, vise souvent la même catégorie de la population, qu’elle est parfois mal perçue ?
C’est vrai, mais aussi parce que les difficultés émanent aussi, par un effet de zoom, d’une partie des élèves de confession islamique, dans l’école publique, ceci d’une part. D’autre part, il y a un sujet sulfureux, épineux, obsédant, lié à l’islam dans notre pays – qui sera, en principe, en voie de normalisation et de banalisation, avec le temps.
Cette obsession, pour reprendre votre terme, relève-t-elle selon vous de l’islamophobie ?
Le vocable « islamophobie » déjà pose problème, alors que ce terme est utilisé par des instances internationales et par l’ONU. Le mot est récusé en France au prétexte que l’employer empêcherait toute critique de l’islam. Si on ne veut pas reconnaître ce mot, il lui faut un substitut. Or dénoncer l’islamophobie n’empêche pas de critiquer la religion islamique. Toute critique théologique est nécessaire. Toute doctrine qui esquive le débat, le choc des idées, qui ne s’exprime dans la clarté, finit par s’étioler et de provoquer pour les croyants une asphyxie qui pousse à se réfugier dans le fanatisme. Si la critique est populaire, elle est salutaire ; si elle est académique, elle est bénéfique. Rejeter le mot ne va pas pour autant effacer des réalités, faites de haine et d’exécrations des musulmans. Il n’y a pas de mot pour définir précisément cette détestation des personnes réelles qui subissent les méfaits de cette haine. Je l’appelle « misislamie » : ce n’est pas la peur de l’islam, mais la détestation des personnes qu’on suppose appartenir à la communauté musulmane.
Quel rôle l’Etat doit jouer dans l’apprentissage et l’intégration de la laïcité auprès des jeunes, à côté d’autres acteurs de la société civile ?
Tout le monde doit s’y mettre, y compris l’Etat, les pouvoirs publics et l’institution scolaire, sans pour autant avoir une matière dédiée à son enseignement mais d’abord en formant les formateurs, le corps enseignant, en expliquant de façon transdisciplinaire les vertus de la laïcité. Expliquer qu’on ne gouverne plus la cité selon le désir politique de Dieu mais qu’on est membre comme citoyen d’une société composite, plurielle, diversifiée, n’ayant pas de référent religieux qui la caractérise. Une société dans un pays avec un Etat qui garantit tant la liberté de conscience que le libre exercice du culte dans le respect de l’ordre public. Il est du devoir des institutions et de l’Education nationale, ainsi que des dignitaires religieux, chacun dans sa confession, d’avoir cela en tête en permanence. La laïcité comme acquis de la modernité politique et intellectuelle est une conquête de l’esprit humain, c’est une culture, un mode de vie. C’est pourquoi l’éducation, l’acquisition du savoir et la connaissance restent les maîtres mots pour sortir de cette crise. L’appareil législatif et les réglementations du politique sont nécessaires mais pas suffisants. C’est une affaire qui doit irriguer l’ensemble de la vie de la société.
A quel endroit la Fondation pour l’islam de France, que vous présidez, tente-t-elle de se positionner dans ce dialogue ? Vous sentez-vous assez entendu ?
Nous traitons au sein de la fondation des sujets éducatifs, civilisationnels et culturels non purement religieux et cultuels. Mais nous pâtissons d’une double contrainte et d’attaques concomitantes : d’un côté, les fondamentalistes salafistes ou des identitaires musulmans nous reprochent de ne pas défendre la « communauté musulmane », une notion bien difficile à définir tant elle est hétérogène, multiple et divisée. De l’autre, nous sommes suspectés d’être des crypto-islamistes, accusés de proximité avec le radicalisme, de louvoyer et de négocier avec le principe de laïcité. Bien évidemment, ce n’est ni l’un ni l’autre. Au contraire, de ville en ville et de quartier en quartier, grâce à l’université populaire itinérante que j’ai instaurée, nous portons en permanence le débat sur ces questions. Nous tentons de le dépassionner et de confronter les idées, pour expliquer et asseoir le principe de laïcité. Nous finirons par être entendus sur ces sujets cruciaux, ce sont notre mission et notre ambition.
Lire la version courte sur le journal Libération
Parue le 1er septembre 2023